Le livre “Zooms sur la classe de mathématiques” coordonné par Julie HOROKS (LDAR, Université Paris Est Créteil, IREMS de Paris) et Aline ROBERT (LDAR, IREMS de Paris) est sorti en juillet.
Résumé
Entretien avec les auteures
Pourquoi une suite au livre « Une caméra au fond de la classe » ?
Une réponse en trois temps !
1) Face aux difficultés que rencontrent les enseignants de math, nous continuons à faire le pari des formations, et notamment des formateurs – ce livre y est dédié, comme le premier tome
2) Ces formations sont pensées comme s’appuyant à la fois sur des éléments issus des recherches en didactique des math (mais à adapter) et sur les pratiques et expériences des participants – comme le précédent, ce livre présente, dans des chapitres spécifiques, des exemples de formations s’inscrivant dans les deux conditions
3) Or il y a du nouveau dans nos recherches par rapport au premier tome ! D’où ce « deuxième tome » …
Et d’où le titre ?
Oui, le titre annonce qu’on va prendre comme points de départ des aspects liés à la classe, étudiés dans ces Zooms sur la classe annoncés, qui nourriront des formations de formateurs et d’enseignants faites à partir des pratiques enseignantes – on élargit ainsi l’appui sur les pratiques qui reste essentiel en utilisant non seulement des vidéos de classe mais aussi d’autres ressources directement liées aux pratiques.
Alors quelles nouveautés ?
Des recherches sur les moments d‘exposition des connaissances complètent celles sur les résolutions d’exercices largement représentées dans le tome 1, conduisant à réfléchir spécifiquement à ces « cours » pendant lesquels les activités des élèves restent bien mystérieuses…
Un autre complément sur l’intégration des technologies numériques en classe de mathématiques permet de penser des formations spécifiques pour contrer les difficultés dont témoigne la lenteur des progrès dans ce domaine.
Plus nouveaux les deux chapitres sur le langage verbal, si essentiel à prendre en compte notamment dans des classes d’élèves défavorisés, et sur les évaluations formatives, qui gagnent beaucoup à être explicitées, à côté des évaluations sommatives. Y sont présentés simultanément les outils à partager et des modalités possibles de séances de formation.
Dans un autre chapitre les auteur.e.s illustrent la manière d’élargir à des formations initiales le principe de s’appuyer sur les pratiques des participants, alors même que celles-ci semblent embryonnaires…
Enfin, élargissant encore le point de vue, un chapitre présente la possibilité d’utiliser des simulateurs pour travailler à partir de pratiques, mais cette fois simulées.
C’est tout ce qu’il y a dans le volume ?
Non, comme dans le tome 1, une deuxième partie est consacrée à des informations et des compléments, sur le contexte actuel et nos recherches, et surtout sur les neuro-sciences. Dans le chapitre qui y est consacré, l’auteur s’attache à mettre en regard sur un sujet précis leurs résultats et l’exploitation qui en est proposée et ceux de la didactique des math, donnant ainsi les moyens d’une appréciation critique.
Qui sont les auteures ?
Il y a 5 autrices principales (M. Abboud, A. Chesnais, L. Coulange, J. Horoks, A. Robert) qui ont collectivement pensé l’ensemble de l’ouvrage, écrit (ou co-écrit) les 7 premiers chapitres et produit la conclusion. Elles partagent pleinement les principes de base déjà évoqués, qui nourrissent effectivement leurs propres formations, y compris pour certaines dans des dispositifs collaboratifs de longue durée, qui feront peut-être l’objet, qui sait, d’un tome 3 !
Les 5 autres auteurs-autrices ont collaboré à l’écriture d’un de ces 7 chapitres (M. Paries, G. Train), à des compléments (L. Nyssen) et aux chapitres sur simulations et neuro-sciences (F. Emprin et E. Roditi).
Mais vu vos présupposés, un tel livre ne peut pas suffire à (se) former ?
Oui, c’est vrai ! Nous le considérons comme une ressource amenant par exemple les formateurs à concevoir certaines séances de formation, si possible collectivement !
Alors, pour finir, qu’est-ce qui manque encore ?
Bien des choses en somme… Notamment des évaluations des formations issues de ces principes partagés ! Mais aussi des recherches, par exemple sur les différences entre élèves, entre enseignants et futurs enseignants, entre contenus à enseigner, ou encore sur le long terme (temps long des apprentissages et des formations), ou même sur les rapports entre apprentissages collectifs (classe) et individuels… Vers des tomes ultérieurs donc !
Informations
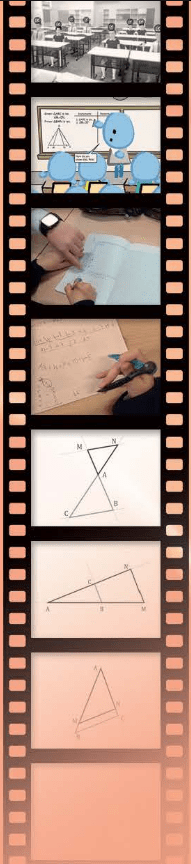
À lire aussi

Quelles mathématiques pour les enseignants de mathématiques ?
Cette année le colloque de la Corfem aura lieu à Dijon les 10, 11 et 12 juin 2026. Deux thèmes sont mis en avant : Quelles mathématiques pour les enseignants de mathématiques ? Formation des enseignants de mathématiques du secondaire : nouveaux dispositifs, nouveaux...
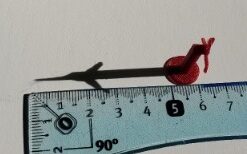
Repères IREM, le numéro 140 en ligne
Le numéro 140 de la revue Repères IREMS est en ligne. Sommaire : 0 - Éditorial 1 - Des mathématiques comme en l'an 500 : découvrir les suites numériques dans l'institution arithmétique de Boèce 2 - La place de l'histoire des mathématiques dans la formation des futurs...
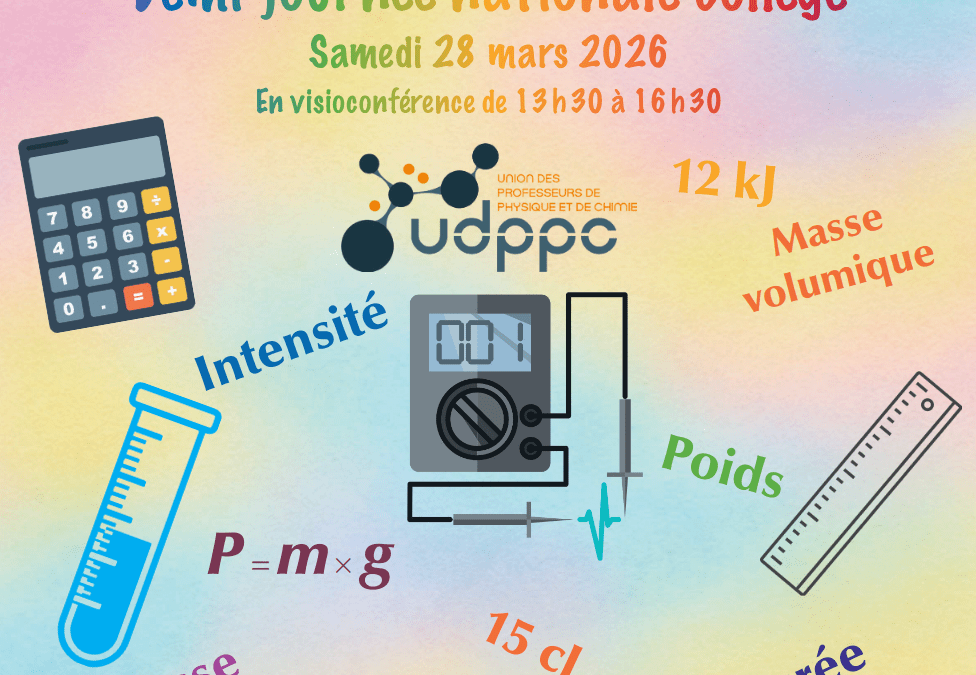
Mathématiques des Grandeurs, de la 6e à la 2nde
Le 28 mars 2026, l'UDPPC organise une demi-journée de réflexion sur le thème : Mathématiques des grandeursen physique-chimie de la 6e à la 2de. L'événement a lieu en visioconférence, pour recevoir le lien de connexion à cette demi-journée, il suffit de s’inscrire via le...

Brève de bibliothèque, décembre 2025
Comme beaucoup le savent désormais, j’ai repris depuis la mi-juillet le poste de bibliothécaire, en remplacement de Jérôme Barberon. Je relance donc les Brèves de la bibliothèque, après quelques mois d’interruption. Dans cette édition, vous trouverez un focus sur des...
